Recherche documentaire
La Fondation Médéric Alzheimer diffuse chaque mois une revue de presse nationale et internationale, 100 % digitale. L’équipe vous propose une sélection d’articles incontournables pour accéder à l’essentiel de l’information en un clic.
C’est une veille à 360 °qui s’intéresse aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants, qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels mais aussi à l’environnement médical, social, juridique, politique et économique de la maladie.
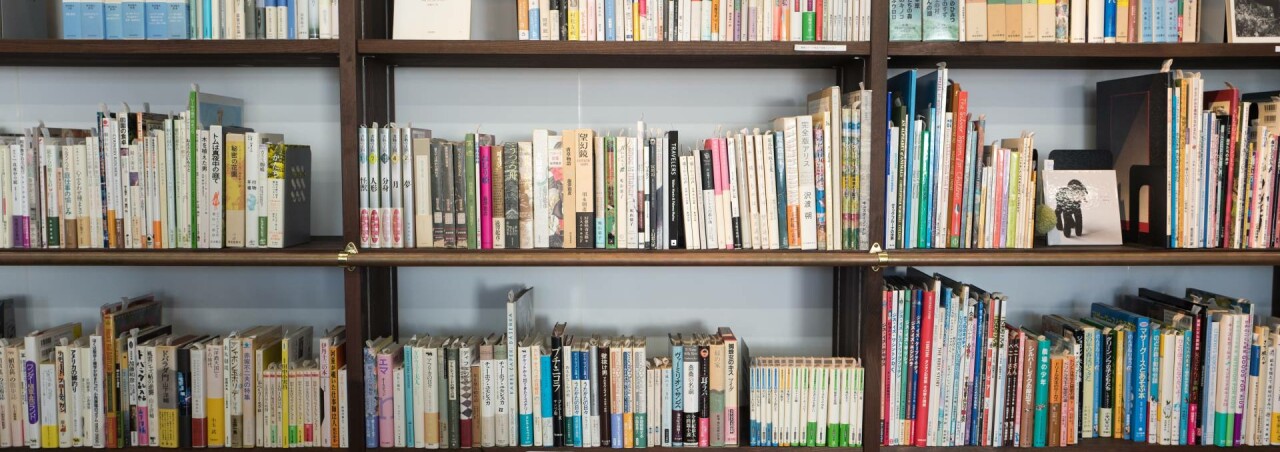
-
01 août 2017
Les Chroniqueurs de la démence
Au Royaume-Uni, Le projet DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project : projet pour la participation et la mise en capacité des personnes atteintes de démence), soutenu par la Fondation Joseph Rowntree, rassemble des groupes de personnes malades au Royaume-Uni, pour les aider à « essayer de changer les dispositifs et les politiques qui affectent leur vie (http://dementiavoices.org.uk/). » Dans ce cadre,…- Société inclusive
-
01 août 2017
La qualité de la présence
Comment affronter la grande désorientation que provoque la maladie d’Alzheimer, chez les personnes malades comme chez leurs proches ? Depuis dix ans, l’association Georges Allimann-Zwiller accueille des malades en journée dans son domaine de Doppelsburg (Haut-Rhin). L’association a mis en place un système de transport, pour chercher et ramener les personnes chez elles. L’an dernier, cent vingt personnes ont profité…- Société inclusive
-
01 août 2017
La remise en cause de l’approche biomédicale de la maladie d’Alzheimer
« Et s’il fallait aborder autrement la maladie d’Alzheimer ? s’interroge la journaliste suisse Nathalie Gerber McRae, du Courrier, qui a interviewé les « chercheurs dissidents » Martial van der Linden et Anne-Claude Juillerat van der Linden, tous les deux docteurs en psychologie, respectivement professeur et chargée de cours à l’Université de Genève. Pour les animateurs du blog Mythe Alzheimer, « les postulats, concepts et…- Société inclusive
-
01 août 2017
« La démence n’est pas un gros mot »
« Alors que la Société Alzheimer britannique lance sa plus grande campagne de sensibilisation, Unis contre la démence, je veux parler honnêtement et ouvertement des problèmes que j’ai vécus dans la vie et dans ma ville lorsqu’il s’agit de démence. Ma mère est somalienne, et a appris son diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016 », explique Khadra Abdi, jeune aidante. « Une des…- Société inclusive
-
01 août 2017
Prix Robert-Guillain de l’Association de presse France-Japon
Pour la quarantième année, l’Association de presse France-Japon (APFJ), qui regroupe des journalistes intéressés par le Japon et leurs homologues japonais en poste en France ou en Europe vient de décerner son prix Robert-Guillain, qui récompense chaque année deux projets de jeunes journalistes professionnels ou en formation pour un reportage de longue durée au Japon. Estelle Dautry, journaliste à Radio…- Société inclusive
-
01 août 2017
Le voleur de visage (El ladrón de caras), des étudiants de l’école d’animation de Valence
« Voici un film d’animation qui nous vient d’Espagne », écrit Pierre-Alain Levy, de wukali.com. « Il a pour titre “Le voleur de visage” et il va vous surprendre. De prime abord cela commence comme un joli petit film, bien fait, bien séquencé, une atmosphère de polar, des éclairages de nuit quelque peu glauques et inquiétants, un détective style Philip Marlowe et sa…- Société inclusive
-
01 août 2017
Le bonheur plus fort que l’oubli, de Colette Roumanoff
« De son expérience de la maladie d’Alzheimer, elle avait déjà tiré une pièce, La Confusionite, écrite avec sa fille Valérie », rappelle Susie Bourquin, d’Infirmiers.com. Dans son livre Le bonheur plus fort que l’oubli – Comment bien vivre avec Alzheimer, elle livre son témoignage, tout en formulant un vœu : « Que ce livre permette aux aidants qui le souhaitent de vivre leur…- Société inclusive
-
01 août 2017
Bande dessinée
Le site www.alzjunior.org, de la Fondation Vaincre Alzheimer (anciennement Ligue européenne contre la maladie d’Alzheimer-LECMA), comprend « différentes rubriques visant à expliquer et dédramatiser la maladie d’Alzheimer : articles détaillant le fonctionnement du cerveau et de la maladie d’Alzheimer avec des mots simples et bien choisis, conseils pour aborder son papy ou sa mamie de la meilleure des manières, réponse à…- Société inclusive
-
01 août 2017
Poésies
« Des plaintes ronchonnes ou des coups (gripes or hacks) ? je ne m’en rappelle aucunement. Des pièges à taupes ? Maintenant il fait sombre et c’est déroutant. Voici un objet familier. C’était dans la maison et on s’en servait pour peser. Ce serait sympathique de s’en servir à nouveau. Il y a une chose qu’on ne peut pas me redonner : l’odeur de…- Société inclusive
-
01 août 2017
Nos mémoires imaginaires, une pièce créée par des personnes malades et des lycéens, mis en scène par Catherine Decastel
Au théâtre Berthelot de Montreuil (Seine-Saint-Denis), des résidents atteints de troubles cognitifs de la résidence Diane Benvenuti (maison de retraite de la Fondation de Rothschild) et des élèves du lycée Grégor Mendel ont joué Nos mémoires imaginaires, une pièce qu’ils ont créée. Pauline, Chloé, Luca, Yannis, Dalia et leurs camarades sont en classe de première, filière services de proximité et…- Société inclusive
